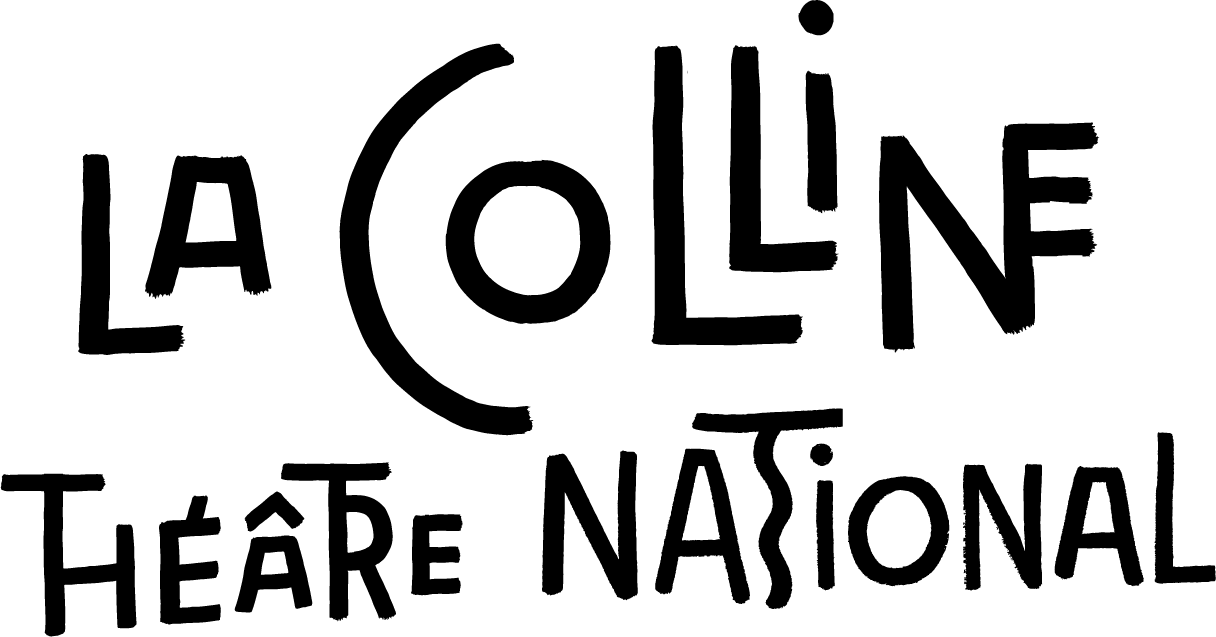Comment finir ?
Entretien avec Wajdi Mouawad autour du spectacle Willy Protagoras enfermé dans les toilettes.
En choisissant de mettre en scène comme dernière création à La Colline « Willy Protagoras enfermé dans les toilettes », première pièce écrite et achevée, vous conjuguez simultanément deux verbes qui sont, comme vous aimez les appeler, deux verbes de l’écriture : commencer et finir. Qu’évoque pour vous l’association de ces deux verbes ?
Ce qui me vient est la figure de la spirale, davantage que celle du cercle. La spirale revient d’une certaine manière au même point, mais à un niveau qui n’est ni supérieur, ni inférieur, simplement autre. Ce moment correspond pour moi à l’achèvement d’une étape, sur un chemin très personnel. Je pourrais distinguer trois temps sur ce chemin, qui correspondraient aux trois tiers d’une vie. Le premier tiers a consisté à apprendre une autre langue, à déménager, à accepter les morts, les pertes. Apprendre et accepter que la vie est brutale, difficile, et faire avec. Apprendre même à devenir imperméable, comme une sorte de défi à toute idée de tristesse, de chagrin, de ressassement du malheur. Refuser ça obstinément, le rejeter totalement. Le deuxième tiers aura été le théâtre, avec des compagnies, petites puis plus importantes, avec la direction d’un premier théâtre, d’un second, jusqu’à La Colline. Il y a quelques années, j’ai compris que le moment était venu de terminer ce second tiers, pour me trouver, avant mes 60 ans, dans un endroit de liberté, sans équipe, sans structure, sans rien, et ainsi entretenir seulement un lien privilégié à l’écriture – qui demande tant de temps, de silence, de calme et de vide. Depuis, j’amorce cette descente, comme dans un voyage en avion – pour atterrir à Paris, il faut commencer à perdre de l’altitude à Lyon – en réfléchissant à cette question : « comment finir ? ».
Et Willy m’est apparu.
Il y a quelque chose de joyeux à finir avec Willy, et non avec une pièce qui chercherait à faire avec la démonstration d’un savoir-faire, ce qu’on pourrait pourtant attendre après 40 ans d’écriture de pièces de théâtre. En choisissant pour dernière création la première pièce que j’ai écrite, je reviens vers le geste d’un auteur de 19 ans. Ce qui est particulier avec la première pièce d’un auteur et qu’on ne retrouve pas dans les suivantes, c’est qu’elle porte en elle la raison de l’écriture, qu’elle porte en elle son désir, incandescent, pur, entier. Au moment de Willy, seul ce désir, celui d’écrire, comptait. Willy est aux antipodes de Tous des oiseaux, première pièce que j’ai créée à La Colline et dont la dramaturgie est si réfléchie, si construite. Là, rien de tel. C’est même « n’importe quoi ». Mais un « n’importe quoi » qui exprime une très grande liberté, jusque dans la manière de faire du théâtre. Je trouvais intéressant de finir avec l’histoire d’un adolescent qui se barricade pour « faire chier » sa famille et ses proches.
De grâce mettez-moi l’habit bariolé
Pour que je puisse enfin dire ce que je pense.
Et je vous purgerai à fond le sale corps
Du monde corrompu, pourvu qu’on laisse agir
En lui patiemment ma juste médecine.
—
Shakespeare, Comme il vous plaira
Il y a là une idée qui m’est chère, et qui aura traversé ces 40 ans d’écriture : il faut questionner qui on est, pas l’autre, il faut questionner ses propres certitudes, oser questionner son groupe, sa famille, sa tribu, quitte à déranger. Surtout à notre époque. Les premières répliques du spectacle sont « il fait un temps dégueulasse », « il fait un temps de merde », « bref il fait pas beau », phrases qu’on pourrait compléter à sa guise, et aujourd’hui par « il fait un temps dégueulasse pour la démocratie », ou « il fait un temps de merde pour les artistes », ou « il fait pas beau pour l’être humain. » Sous cet angle, la pièce prend une portée que je ne lui soupçonnais pas à l’époque.
Pourtant c’était bel et bien déjà présent puisque la pièce naissait d’un énorme cri de colère adolescent. Ce cri exprimait un désir féroce de refuser, de dire non. Non ! Finir par Willy, c’est revenir à ce par quoi j’ai commencé, une envie de contester, même sans trop savoir quoi. C’est offrir ce cri, alors que l’adolescence est passée et que la jeunesse est métabolisée.
Willy dit deux phrases qui semblent mystérieusement se répondre : l’une, « la guerre m’emmerde », l’autre, « la perte n’est rien ». Que dessinent ces deux phrases ?
Cette étonnante association pourrait être reliée à un déclic qui s’est produit à peu près au moment de l’écriture de Willy et qui a été d’une importance considérable. J’étais à l’école de théâtre, une période extrêmement pénible pour moi. Un jour, alors que j’attendais à un feu, j’ai été traversé par cette pensée : « j’ai 20 ans ». C’était beaucoup. Et en une fraction de seconde j’ai listé tout ce que j’avais fait dans ma vie : vu la mer, un ciel bleu, la neige, pris l’avion, rigolé et joué au foot avec des copains et tant d’autres choses encore. Et soudain je me suis dit : « Maintenant je peux mourir ». Tout ce qui pouvait m’arriver désormais serait du bonus. Cette pensée a aussitôt fait apparaître une porte, qui ne dépendait que de moi, par laquelle je pouvais me dérober et ne plus jamais me retrouver coincé. Si la vie devenait trop difficile, j’avais juste à ouvrir cette porte et sortir. Cette porte, c’était l’écriture. Cela a eu pour conséquence immédiate de me détendre et d’oser oser, car peu importait ce qui arriverait, tout irait bien : je m’en fichais. Cela n’empêche pas de faire du mieux que l’on peut, mais on relativise si cela ne fonctionne pas. Car des choses incroyables ont déjà été vécues. Chaque bonus vécu par la suite a renforcé cette insouciance et cette forme de liberté dans l’acte de créer.
Cette intuition est présente dans Willy quand Marguerite Cotaux lui dit : « Tu vas mourir, Willy mais quelque chose de plus grand que toi […] survivra ». C’est une manière de dire : tu vas mourir mais tout va bien, parce que tu es convaincu de ce que tu fais, et c’est formidable. Willy ne veut pas être un héros, prêt à mourir pour une cause. Pour autant il ne veut pas être celui qui refuse
à tout prix de mourir. Il s’oppose surtout à ce que quiconque puisse accaparer son être. En cela, il ressemble au Talyani montréalais de Racine carrée du verbe être, qui trace un cercle autour de lui et prévient : je vais rester gentil, mais si vous franchissez cette ligne, je mordrai. Cette limite, des toilettes ou du cercle de craie, marque un territoire lié à ce qu’on pourrait appeler « l’Ombre de chacun », grâce à laquelle on émet une lumière. Cette ombre produit le champ d’existence propre à chacun. Il est difficile de la nommer, mais il faut la sentir : c’est ce que vit Willy dans sa bataille instinctive à empêcher quiconque de le restreindre, de l’éteindre.
Willy pourrait choisir de fuir le chaos. Pourtant il choisit de rester dans l’appartement. Une part de lui ne peut abandonner les siens, ne peut renoncer à eux. En s’enfermant dans les toilettes, il est, à sa manière, « solitaire mais solidaire », comme l’écrit Camus. Il ne pose pas une limite seulement dans son intérêt, il le fait aussi pour les autres. Cela me fait penser à ce que, un jour, un ami, François Ismert, m’avait expliqué et qui m’avait frappé : chez les Grecs, celui qui ne s’occupe que de ses affaires et se désintéresse des problèmes de la cité est appelé l’idiot, ἰδιώτης. D’une certaine manière, Willy prend part aux affaires de la cité, c’est-à-dire de son appartement, de son immeuble. Son geste est empreint d’amour, empreint de la nécessité de trouver une solution. C’est en un sens un être politique, engagé dans les questions communes, collectives. Et cet engagement lui est possible car il ne craint pas de mourir. Il s’en fiche. Et en ce sens, il est heureux. Il refuse la guerre, la violence. Et comprend qu’il existe une manière de gagner qui consiste à perdre.
Peut-on voir dans Willy les prémices du rapprochement entre l’artiste et le scarabée ?
Le scarabée est un insecte qui se nourrit des excréments d’animaux autrement plus gros que lui. Les intestins de ces animaux ont cru tirer tout ce qu’il y avait à tirer de la nourriture ingurgitée par l’animal. Pourtant, le scarabée trouve, à l’intérieur de ce qui a été rejeté, la nourriture nécessaire à sa survie grâce à un système intestinal dont la précision, la finesse et une incroyable sensibilité surpassent celles de n’importe quel mammifère. De ces excréments dont il se nourrit, le scarabée tire la substance appropriée à la production de cette carapace si magnifique qu’on lui connaît et qui émeut notre regard : le vert jade du scarabée de Chine, le rouge pourpre du scarabée d’Afrique, le noir de jais du scarabée d’Europe et le trésor du scarabée d’or, mythique entre tous, introuvable, mystère des mystères.
Un artiste est un scarabée qui trouve, dans les excréments mêmes de la société, les aliments nécessaires pour produire les œuvres qui fascinent et bouleversent ses semblables. L’artiste, tel un scarabée, se nourrit de la merde du monde pour lequel il œuvre, et de cette nourriture abjecte il parvient, parfois, à faire jaillir la beauté.
—
Wajdi Mouawad
On pourrait voir une analogie amusante mais tout à fait involontaire entre l’image ultérieure du scarabée qui m’est chère et Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Mais en réalité ce qui prime chez Willy est le besoin de « faire le truc qui va désespérer. ». J’ai écrit la pièce alors que je vivais au Canada, pays soucieux de la propreté, même morale. Une autre pièce écrite à cette époque, Partie de cache-cache entre deux Tchécoslovaques au début du siècle, débute d’ailleurs par ces mots : « c’est trop propre ici. ». Tout me semblait trop poli, trop propre, trop tout, alors qu’il suffisait de regarder autour de soi – je pense aux Premières Nations par exemple – pour se rendre compte que tout était loin d’être propre. Pour être plus sincère encore, j’étais surtout habité du simple désir de « faire caca », c’est-à-dire de dire non. Et c’est drôle le caca quand tu as 19 ans. Tu penses être provocateur en créant un personnage qui défèque sur scène, en écrivant les répliques les plus grossières et les plus inventives possibles. C’est jouissif, ça te fait rire ! Tu ne penses pas à la portée politique du propos, ni à sa portée métaphorique. Tu imagines des gens sérieux, des universitaires, des psychanalystes, dire que tu n’es pas sorti de ta phase anale et tu t’en fous, tu les « emmerdes » justement. Certes, ça ne ressemble pas à Sophocle, mais ce théâtre-là a tout autant le droit d’exister, l’auteur a tout autant le droit de parler. C’est véritablement cet élan-là qui m’a fait écrire. Se venger des adultes qui prétendent savoir ce que doit être le théâtre et te rabâchent que Shakespeare et Rimbaud sont des génies tandis que tu n’es qu’un incapable. C’est terriblement écrasant, surtout quand on a 20 ans. Alors on se tait jusqu’au jour où on décide de ne plus se laisser faire. Peut-être est-ce là aussi une des choses qui me tient à cœur : rappeler que le théâtre peut aussi être ça, ou autre chose. Surtout à notre époque, où l’on a tant besoin de paix.
Sans la nommer, la pièce est calquée sur la guerre civile libanaise et particulièrement sur le conflit libano-palestinien. Est-il possible de nous en rappeler le contexte ?
Willy fait référence au conflit entre les communautés chrétiennes dont je suis issu et les communautés palestiniennes entrées au Liban après la création de l’État d’Israël. Il est essentiel de souligner que, même si certains aspects – les questions de territoire, les noms de certains personnages – peuvent faire écho aujourd’hui au conflit israélo-palestinien, la pièce n’évoque que le conflit libano-palestinien, historiquement et fondamentalement différent. Pour le résumer très succinctement, la présence des Palestiniens – qui au Liban sont des exilés, vivent dans des camps et espèrent rentrer chez eux –, va créer de très grandes tensions entre des factions de droite ou d’extrême droite, généralement chrétiennes, et des factions plus progressistes, souvent musulmanes. Ces tensions vont engendrer la guerre civile libanaise, riche en monstruosités, massacres et autres horreurs.
L’idée d’écrire Willy est née en 1989. La guerre civile libanaise entre alors dans une étape charnière, dont la pièce est le reflet. Dans ces années-là se produit un événement singulier. Michel Aoun, ancien général de l’armée libanaise, rassemble des Libanais de toutes les confessions, de l’armée, ou des milices, et s’enferme avec eux dans le palais présidentiel pour se rebeller contre les armées étrangères présentes dans le pays – syrienne, israélienne, américaine, française – avec cette intention : « Quittez le Liban, on va se débrouiller tout seuls ». Une sorte de guerre, inspirée par une volonté de réappropriation non du territoire, mais de la possibilité de trouver un compromis entre Libanais, sans qu’il soit décidé et mis en œuvre par – et pour – des forces extérieures.
Quand j’ai appris cette situation, en lisant le journal au Québec, l’idée du spectacle a surgi d’un coup : un type retranché dans les toilettes qui en bloquerait l’accès pour contraindre les « intrus » à sortir. D’une certaine façon, l’immeuble de Willy représente le Moyen-Orient et l’appartement des Protagoras – le plus bel appartement – représente le Liban. C’est ce que l’on disait de lui : le Liban donne sur la mer, est tempéré, dispose de montagnes enneigées l’hiver et d’une terre fertile. Le notaire, lui, qui voudrait abattre la cloison pour réunir l’appartement des Protagoras au sien, renvoie à la Syrie. À l’époque en effet, Hafez al-Assad régnait en maître sur la Syrie et voulait retrouver l’âge d’or de la grande Syrie, quand le Liban était intégré au pays. Lorsqu’en 1991, l’Irak envahit le Koweït, les États-Unis attaquent l’Irak pour défendre leurs intérêts pétroliers et pour éviter que la Syrie n’intervienne en faveur de l’Irak, les pays occidentaux négocient avec elle de lui laisser toute latitude au Liban. Les accords de Taëf, qui marquent la fin de la guerre civile libanaise, actent cette mainmise en stipulant le désarmement des milices et la présence de la Syrie au Liban pour assurer la sécurité et la protection de la paix. La guerre s’achève avec l’échec de Michel Aoun, la signature de ces accords et l’entrée de la Syrie au Liban. Les quinze années qui suivront resteront très violentes, marquées par des assassinats d’intellectuels et de journalistes libanais qui s’opposent à cette dictature au front caché.
Le 13 avril 1975, avec la fusillade d’un autobus palestinien à Beyrouth, commencent quinze ans de guerre civile au Liban, aux causes à la fois régionales et nationales. Le système institutionnel, économique et social du Liban repose, depuis le « Pacte national » de 1943, sur les appartenances confessionnelles. La présence des réfugiés palestiniens est perçue comme bouleversant cet équilibre. Alors que le partage du pouvoir favorise les chrétiens maronites, se constitue un mouvement hétérogène alliant, dans un premier temps, les exclus des richesses économiques et les adversaires du régime ; le « Mouvement national » libanais en appelle à la solidarité avec la résistance palestinienne. Les phalangistes chrétiens feront d’abord appel à l’aide de la Syrie, qui interviendra en 1976 et contribuera aux massacres de réfugiés palestiniens, avant de se retourner contre ses premiers alliés. La guerre civile se poursuivra tandis qu’Israël envahit le Sud-Liban en 1978 puis déclenche une nouvelle offensive en 1982 baptisée « Paix en Galilée », soumettant Beyrouth aux bombardements et à un blocus, avant de conclure un cessez-le-feu avec la Syrie. Les forces israéliennes pénètrent dans Beyrouth le 15 septembre 1982, après l’assassinat de Bechir Gemayel, chef des Phalanges et président. Les massacres des réfugiés palestiniens des camps de Sabra et Chatila commencent le lendemain. Les années 1983 à 1985 sont marquées par la radicalisation et la recrudescence des combats entre milices et factions rivales. Même si les accords de Taëf d’octobre 1989 y mettent théoriquement fin, affirmant la restauration de l’autorité de l’État et l’interdiction de toute annexion de son territoire, l’armée israélienne ne se retirera du Sud-Liban qu’en 2000.
Comment la distribution a-t-elle été imaginée ?
Les comédiens sont 19. Choisir une troupe si conséquente est un acte en soi – qui se raréfiera avec les conditions budgétaires auxquelles nous devons nous attendre. Il n’y a pas de vidéo, le décor se compose essentiellement d’éléments scénographiques anciens, récupérés et modifiés : les chaises d’Incendies et de Forêts, les modules de Racine carrée du verbe être, une partie du sol de Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge, des costumes piochés de-ci de-là. Le budget est en majorité consacré à l’humain. Près de 30 personnes au total collaborent à ce projet. J’aime l’idée que le coût de cette production corresponde à l’engagement de gens heureux de faire leur métier.
Travailler avec 19 comédiens implique que tous soient capables de maîtriser leur ego, leurs incertitudes et difficultés personnelles, qui, sans garde-fou, peuvent facilement devenir des espaces de crispations et de tension. C’est pourquoi j’ai eu à cœur de m’entourer d’acteurs « gentils », ce qui ne signifie pas mièvres, mais agréables, sympathiques, drôles. Drôles. Car en écrivant Willy, je me suis beaucoup amusé – et cet amusement est ce qui m’a permis d’ailleurs d’achever une pièce pour la première fois. L’amusement devait faire partie de cette création. Nous devions rire pour être au bon endroit. Cet état d’esprit appartient à la dramaturgie du texte. J’ai donc choisi des comédiens incarnant cette double nature, la gentillesse et la joie.
Ces comédiens sont de générations et de parcours différents. Parmi eux, se trouvent des comédiens avec qui j’avais envie de travailler depuis longtemps. J’ai fait la connaissance de Micha Lescot lors des créations d’Amos Gitaï à La Colline. Nous nous sommes immédiatement bien entendus, d’un âge semblable, partageant des conversations fortes. Je l’ai approché pour le rôle de Maxime Louisaire. Mais après avoir lu la pièce, il m’a avoué son embarras : « Je voudrais jouer Willy, mais je sais que ce n’est pas possible, il a 19 ans et moi 50 ». Son désir a été pour moi une clé fondamentale : j’avais l’âge de Willy en l’écrivant – et en le jouant à sa création – et désormais j’avais l’âge de Micha. Le glissement me paraissait plein de justesse. « Tu as raison, joue Willy » ai-je dit à Micha. Dès lors, je me suis autorisé à ne pas toujours faire correspondre les âges des personnages à ceux des comédiens.
Je n’avais encore jamais travaillé avec Pierre-Yves Chapalain non plus. Je l’ai rencontré en tant qu’auteur, l’accompagnant dans l’écriture de Derrière tes paupières par exemple, créée à La Colline. J’adore l’enfance, l’inquiétude, la poésie qu’il y a chez lui. Et le voir au plateau est un bonheur, car il rend son personnage tout à la fois touchant et truculent.
Nous avions avec Johanna Nizard des amis communs, mais c’est en voyant son spectacle, Il n’y a pas de Ajar, d’après le texte de Delphine Horvilleur, que j’ai découvert la comédienne qu’elle était. Et j’ai été impressionné. Par la qualité du jeu, par l’audace de son impudeur, par son infinie délicatesse.
C’était aussi essentiel d’avoir auprès de moi le Québec, qui fait partie de mon identité et de mon histoire, et où Willy Protagoras enfermé dans les toilettes a été écrit et créé. Puisque le rôle de Maxime Louisaire était libre, j’ai soudain eu l’idée de proposer à Éric Bernier de le reprendre, lui qui l’avait endossé à la création. Éric est un comédien ahurissant qui a créé le rôle de Nihad dans Incendies. Et j’ai proposé à Mireille Nagar de reprendre le rôle de la mère de Willy, Jeanine Protagoras, qu’elle jouait aussi à la création. Mireille était en première année à l’École nationale de théâtre du Canada alors que j’étais en deuxième. Nous nous connaissons depuis plus longtemps encore : 1988. Mireille et Éric ont désormais l’âge des personnages et je trouvais merveilleux de le leur proposer 25 ans plus tard.
Je retrouve aussi des comédiens avec qui j’ai souvent collaboré plus récemment : Jade Fortineau, Julie Julien, Lucie Digout, Gilles David. Nelly Lawson et Lionel Abelanski ont chacun fait des reprises de rôle, Nelly dans Tous des oiseaux, Lionel dans Mort prématurée... Willy était l’occasion d’approfondir notre rencontre.
Et bien sûr il y a la Jeune troupe. Sont présents les six comédiens de la promotion actuelle, mais aussi Marceau Ebersolt, issu de la deuxième promotion, et Delphine Gilquin, issue de la première. Cet agrégat construit une mémoire des Jeunes troupes pleine de sens, projet que j’ai particulièrement aimé de ces années à La Colline.
Ce nombre, 19, impose-t-il un travail différent ?
C’est la pièce qui l’impose. Willy se rapproche beaucoup plus d’une partition musicale que d’un texte écrit. Les acteurs doivent dans un premier temps apprendre ce solfège. Je n’ai pas pour habitude de travailler ainsi, mais concrètement pour cette pièce, travailler sur le rythme et la ponctuation de chaque phrase est nécessaire. Je demande aux acteurs d’aller de la majuscule jusqu’au point sans reprendre leur respiration, de placer une césure à tel mot, de regarder leur partenaire à tel autre. Le spectacle ne supportant pas le moindre naturalisme, chaque réplique exige une écriture détaillée des regards, des rythmes, des corps. Une scène de groupe qui dure cinq minutes nécessite des heures de placement. Tout doit être réglé comme du papier à musique. C’est un travail titanesque qui nous occupe tous les jours, un travail de mémoire, de répétition, de précision capital. Les comédiens doivent préalablement parfaitement maîtriser ce solfège, car ils perdent en précision dès qu’ils se saisissent émotivement du texte. Dès qu’ils s’écartent du cadre, ils s’égarent dans le jeu. À l’inverse, plus ils le suivent, plus ils prennent de plaisir et parviennent à jouer. Ce travail d’assimilation est crucial pour qu’on ne le remarque plus et que le texte, grotesque, fragile parfois, puisse faire entendre sa dimension politique et les questions de territoire, de guerre, de médias, des réseaux sociaux même, bien avant leur temps, qu’il soulève.
Lettre aux acteurs
J’écris par les oreilles. Pour les acteurs pneumatiques. Les points, dans les vieux manuscrits arabes, sont marqués par des soleils respiratoires… Respirez, poumonez ! Poumoner, ça veut pas dire déplacer de l’air, gueuler, se gonfler, mais au contraire avoir une véritable économie respiratoire, user tout l’air qu’o prend tout l’dépenser avant d’en reprendre, aller au bout du souffle, jusqu’à la constriction de l’asphyxie finale du point, du point de la phrase, du poing qu’on a au côté après la course. Bouche, anus. Sphincters. Muscles ronds fermant not’tube. L’ouverture et la fermeture de la parole. Attaquer net (des dents, des lèvres, de la bouche musclée) et finir net (air coupé).Arrêter net. Mâcher et manger le texte. Le spectateur aveugle doit entendre croquer et déglutir, se demander ce que ça mange, là-bas, sur ce plateau. Qu’est-ce qu’ils mangent ? Ils se mangent ? Mâcher ou avaler. Mastication, succion, déglutition. Des bouts de texte doivent être mordus, attaqués méchamment par les mangeuses (lèvres, dents) ; d’autres morceaux doivent être vite gobés, déglutis, engloutis, aspirés, avalés. Mange, gobe, mange, mâche, poumone sec, mâche, mastique, cannibale ! Aïe, aïe !... Beaucoup du texte doit être lancé d’un souffle, en l’usant tout. Tout dépenser. Pas garder ses petites réserves, pas avoir peur de s’essouffler. Semble que c’est comme ça qu’on trouve le rythme, les différentes respirations, en se lançant, en chute libre. Pas tout couper, tout découper en tranches intelligentes, en tranches intelligibles – comme le veut la diction
habituelle française d’aujourd’hui où le travail de l’acteur consiste à découper son texte en salami, à souligner certains mots, les charger d’intentions, […] – alors que, alors que, alors que, la parole forme plutôt quelque chose comme un tube d’air, un tuyau à sphincters, une colonne à échappée irrégulière, à spasmes, à vanne, à flots coupés, à fuite, à pression. Où c’est qu’il est l’cœur
de tout ça ? Est‐ce que c’est l’cœur qui pompe, fait circuler tout ça ?... Le cœur de tout ça, il est dans le fond du ventre, dans les muscles du ventre. Ce sont les mêmes muscles du ventre qui, pressant boyaux et poumons, nous servent à déféquer ou à accentuer la parole. Faut pas faire les intelligents, mais mettre les ventres, les dents, les mâchoires au travail. […] Faudra un jour qu’un acteur livre son corps vivant à la médecine, qu’on ouvre, qu’on sache enfin ce qui se passe dedans, quand ça joue. Qu’on sache comment c’est fait, l’autre corps. Parce que l’auteur joue avec un autre corps que le sien.
—
Valère Novarina, Le Théâtre des paroles, P.O.L, 1989
Pour conclure, quel espoir placez-vous dans cette jeunesse ?
Au cours de ces dix années passées à La Colline, j’ai essayé de mettre la jeunesse au centre des préoccupations, en lui donnant la parole dès mon arrivée à travers cette question : « Expliquez-nous ce que l’on ne comprend pas de vous ». Ou pour le dire autrement : « Dites-nous, vous qui êtes jeunes, de quelle manière on vous tue, nous qui sommes adultes ». Il a été poignant de réaliser combien ces jeunes gens restaient souvent sans voix, tant on ne leur avait jamais appris à prendre la parole. Au fil des années, nous avons tenté de mettre en place des outils pour qu’ils puissent le faire, pour qu’ils puissent venir à La Colline, par eux-mêmes, et s’y sentir chez eux.
Comme les générations passées nous ont donné leur richesse, on armera la jeunesse si on leur donne la nôtre sans leur poser de question, sans leur poser de condition. Quelle est cette richesse ? Ce ne sont pas nos connaissances, mais notre énergie de vie, c’est-à-dire notre bonheur, notre joie, nos capacités. Si on accepte qu’ils feront bien ce qu’ils voudront de cette énergie, sans les sommer de trouver des solutions, je crois qu’on les inscrit dans la ligne du temps et de l’histoire.
Or notre énergie s’incarne de toutes sortes de manières : faire du théâtre, leur parler, les écouter nous parler, aimer notre époque, aimer qui nous sommes. Cela nécessite de se dépasser. De résister à la tentation de se croire perdu parce qu’on devient vieux, parce que l’époque, les guerres, le monde. Il faut continuer, continuer à écrire, à faire, parfois à petite échelle, parfois à un peu plus grande, en tentant d’être le plus lucide possible. Accepter, accepter d’avoir été aveugle et d’avoir essayé d’avancer. C’est ainsi que l’énergie s’incarne et se transmet. Elle s’arrête dès lors que l’on se croit perdus.
C’est difficile de prendre ou donner la mesure d’une phrase telle que « j’ai de l’espoir dans la jeunesse ». En revanche je peux affirmer que « je peux donner de l’énergie à la jeunesse, en lui montrant combien la vie est incroyable ». Si la jeunesse décide de rester attentiste, je devrai l’accepter, même si c’est dur, et continuer à donner de cette énergie. Le déclic se fera peut-être plus tard, voire si et seulement si je ne suis pas là. Car il ne faut pas que la jeunesse se retrouve dans une situation où elle nous devrait ce déclic. Il faut qu’elle le doive à elle seule.
—
Entretien réalisé par Marie Bey et Fanély Thirion avec l’aimable collaboration de Charlotte Farcet, dramaturge, décembre 2025