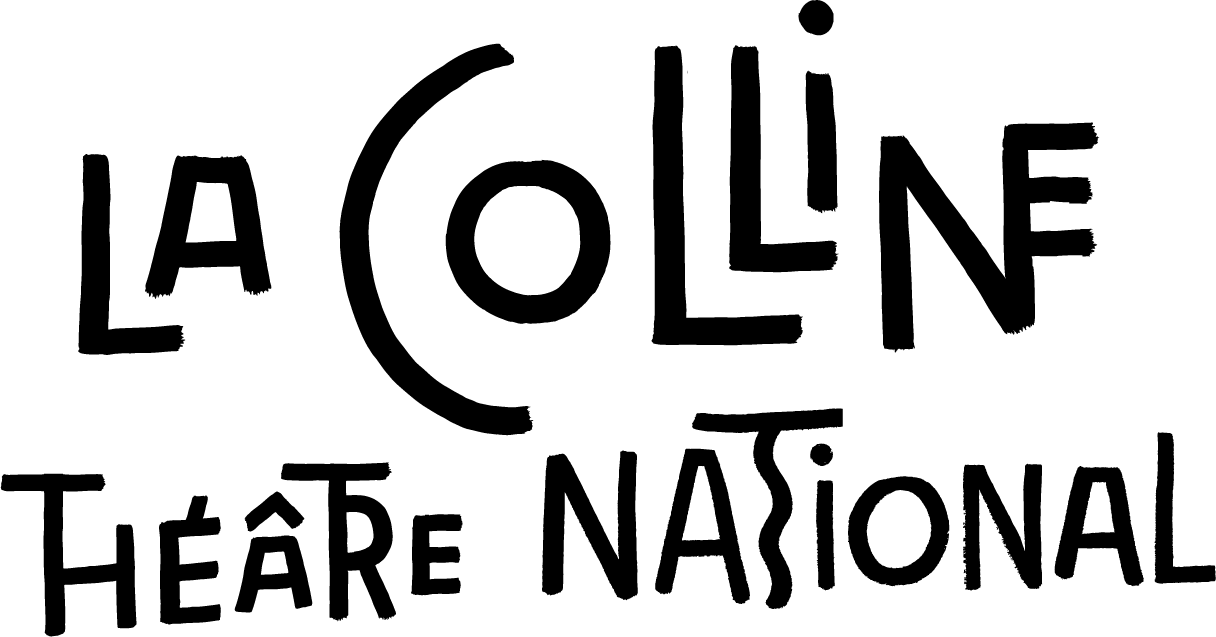Entretien avec Wajdi Mouawad
texte et mise en scène Wajdi Mouawad
du 10 mai au 4 juin au Grand Théâtre
Dérives
Entretien avec Wajdi Mouawad – octobre 2021
Après Seuls et Sœurs, vous poursuivez votre cycle Domestique avec un opus nourri plus encore d’éléments autobiographiques ; reconstituant l’appartement parisien de votre enfance, plongeant dans des archives et vos souvenirs. Comment ce chemin s’est-il imposé ?
Wajdi Mouawad – Le cycle Domestique se compose des cinq membres de ma famille : le père, la mère, la sœur, le frère et moi. Or, si tous ont effectué en substance le même parcours – un départ du Liban pour la France puis le Québec –, aucun ne raconte les mêmes souvenirs de la même manière. Le récit en devient tellement chaotique, polyphonique devrais-je dire, que j’ai eu envie de raconter les points de vue de chacun ; non pour les opposer mais au contraire les exposer, sans qu’ils n’aient à rencontrer de contradiction. À l’instar de Seuls et Sœurs, je voulais coller à la réalité en partant cette fois de ma mère. Mais c’était oublier une autre réalité qui est celle du théâtre, qui fait dériver doucement le récit vers la fiction alors même qu’on est convaincu de rester dans la biographie. J’ai d’abord voulu par exemple recréer l’atmosphère du véritable appartement, celui-ci ayant cristallisé dans ma mémoire toutes mes sensations d’alors. Débarquer d’un pays du bout du monde pour habiter dans le 15e arrondissement un immeuble de style haussmannien avec concierge, ascenseur et moquette avec bosses, alors que j’avais passé toute mon enfance dans une forêt peuplée d’animaux, a pour moi été une expérience lunaire. Mais reproduire cet univers trop réaliste annihilait toute possibilité de poésie. Nous avons donc simplifié et abstrait pour créer du vide et ouvrir l’écriture. Mère est en quelque sorte le fruit de deux notions qui me sont chères : la dérive et l’accumulation. Au mot « dérive », dans le dictionnaire, on trouve cette définition : variation lente d’une grandeur. Au-delà du fait d’être fasciné par la présence d’une phrase aussi poétique dans le dictionnaire, j’ai d’abord interprété le mot « grandeur » comme « beauté », avant de réaliser qu’il s’agissait d’une mesure. Variation d’une mesure. Ce n’est pas sans lien avec cette image que j’aime bien, celle du « sac à dos » : chacun de nous en porte un, vide au début ; mais chaque jour, des événements, des personnes, la vie, ajoutent des petits cailloux si imperceptiblement qu’on ne sent jamais le poids s’additionner ! Les années passant, on ne sait plus pourquoi on se sent mal, n’ayant même plus conscience de la présence du sac. Le jour où un événement immense survient, – la personne dont vous êtes secrètement amoureux vous déclare son amour – le poids du sac s’évapore en un instant et vous ressentez une légèreté inédite. Mais quand cette histoire d’amour s’achève, tout le poids du sac soudainement écrase vos épaules. Alors on s’interroge sur son existence, et sur son contenu. On découvre les cailloux, et on tente de se souvenir de l’histoire liée à chacun d’eux. Mère est aussi cette tentative.
Mère est le premier des opus de Domestique titré au singulier, quelle en est la raison ?
W.M. – Parce qu’on n’a qu’une seule mère. Pourtant derrière ce singulier se cache un pluriel. Tous les Libanais ont deux mères. La seconde, qui les a mis au monde autant que leur propre mère, est la guerre. Je n’échappe pas à cela. Être l’enfant de ces deux mères est une prise de conscience tout à fait réelle. Mes parents sont les premiers alphabétisés d’une lignée de montagnards, qui ne pouvaient que survivre dans les montagnes chrétiennes enclavées de l’Empire ottoman, le fossé me séparant de mon grand-père est semblable à un écart de plusieurs siècles… Il ne s’agit même plus de dérive, mais d’un tout autre destin ! Si j’étais resté au Liban, j’aurais été quelqu’un de complètement différent, sans doute eu d’autres enfants que les miens. C’est vertigineusement troublant de se dire que ces êtres-là existent grâce 7 à un événement aussi épouvantable que la guerre ! De la même manière, je n’aurais probablement jamais fait de théâtre : c’est donc une guerre de 400 000 morts, sans compter les disparus et les conséquences irréparables à venir, qui m’a sauvé ! Un prix chèrement payé, non ? Cela pour dire que des événements aussi singuliers et majeurs que changer de pays, de langue, d’amis, événements subis par l’enfant que j’étais, ne sont certes pas de mon fait mais font ma vie. Parvenir à assumer ce vécu est un chemin. Convoquer votre enfance nécessitait de jouer en libanais or vous n’écrivez pas en arabe.
Comment s’est déroulé le processus de création ?
W.M. – Pour Tous des oiseaux, j’ai écrit un texte en français ensuite traduit en quatre autres langues, ce qui m’a vraiment donné l’impression d’un déplacement vers un lieu inhabituel, une langue autre. À l’inverse, avec Mère, j’ai eu la sensation phénoménale d’être « détraduit », comme si l’on faisait apparaître la véritable écriture. Jusqu’à ce spectacle, j’avais toujours travaillé avec des acteurs qui m’étaient étrangers, qui ne parlaient pas ma langue. Quels que soient les spectacles et l’exceptionnelle qualité des acteurs avec qui j’ai collaboré, le travail que j’ai eu à produire pour les amener au rythme, à la vitesse et au cri qui sont ceux de mon écriture, a été titanesque. Mais ici les deux comédiennes libanaises attrapent le rythme de ce que j’écris sans effort et sans avoir besoin d’être convaincues, tout simplement car elles le connaissent ! Entendant pour la première fois au plateau les mots comme je les pense est ce qui m’a fait réaliser que j’ai toujours écrit en arabe. Comme si on avait enlevé le vernis de français qui voilait la langue aujourd’hui révélée. Pour autant, je comprends dans le même temps que le libanais n’est pas capable de prendre en charge une certaine forme de poésie, de lyrisme qu’il m’importe d’incorporer à l’écriture. Par exemple le monologue final de Tous des oiseaux me semble impossible à traduire en arabe, sauf à devenir de l’arabe classique. Dans Mère, et c’est tant mieux, il n’y a pas la place pour que l’écriture verse dans la poésie, tout simplement parce que ma mère était une femme très concrète. L’écriture est en conséquence très râpeuse, âpre, rêche, à l’image de la situation et l’état dans lesquels était ma mère lorsque nous vivions à Paris. Plus largement, je réalise que ma langue d’écriture n’est ni française ni libanaise, et si je retournais aujourd’hui faire du théâtre au Liban, je serais confronté à un autre choc : même si l’arabe est la langue de la poésie par excellence, ce n’est pas la mienne. Mon écriture est métissée, entrelaçant une phrase de poésie allemande avec une parole de ma mère ou celle d’un autre artiste… une écriture « de coin de table » en somme, « attendant de repartir », comme si ce lien au départ était trop ancré dans mon esprit pour que je m’installe. Et cela agit directement sur la manière et le rythme de l’écriture ; la poésie à laquelle j’accède est celle d’un homme qui n’est pas chez lui. Ce patchwork est une langue de l’exil.
Comment la mémoire de la guerre que vous partagez avec les comédiennes libanaises apparaît-elle au plateau ? Et comment résonne-t-elle au présent ?
W.M. – Le collectif au Liban est infiniment puissant. Dans ce tout petit pays où l’on est peu nombreux, le partage est très charnel, la manière de se parler et de vivre ensemble presque familiale, même avec des inconnus. Les enfants libanais appellent « tantes » toutes les femmes et « oncles » tous les hommes. Quand la guerre civile survient au sein d’une telle culture, elle ressemble à la série Dallas. On s’en raconte les épisodes. Entre deux bombardements, après des tirs opposant voisins, cousins, frères, on se dit : « c’est pas grave », « ça va aller ». Et encore aujourd’hui, après l’explosion du port et vivant sans électricité, beaucoup se disent : « c’est pas grave », « ça va aller ». Ce n’est pas véritablement de la résilience, mais plutôt « que faire d’autre ? », car de toute façon il faut continuer à vivre ensemble. Aïda Sabra, Odette Makhlouf et moi partageons les mêmes souvenirs. Les scènes que j’écris en pensant à ma mère sont des scènes qu’elles ont vécues. Elles sont si réelles pour nous que la mémoire resurgit de façon naturelle dans le corps et la langue. Mais le plus saisissant est qu’elles disent aussi le présent. Lorsqu’on écoute les actualités de 1983 sur la guerre du Liban, on est stupéfaits tant elles nous catapultent en 2021 : 8 mêmes faits, mêmes personnes. Les chefs des milices d’alors sont toujours ceux qui gouvernent aujourd’hui. Et l’inquiétude des familles d’alors est celle des familles d’aujourd’hui, celle d’Odette Makhlouf par exemple, qui vit toujours au Liban et à qui la question de l’exil se pose sans cesse.
Que dire de l’écho provoqué par la brutalité des souvenirs ?
W.M. – Je n’ai pas connu ma mère autrement qu’inquiète et impatiente, sans aucune place pour l’affection, la tendresse ou la douceur. C’était impossible pour elle à Paris. Au Liban, les gens partageaient sa guerre. À Paris, elle était seule. C’était aux nouvelles télévisées d’Antenne 2 qu’on voyait les bombardements de Beyrouth. Il n’y avait alors évidemment ni portable, ni mail. Et les lignes téléphoniques libanaises étaient souvent coupées. On ne pouvait joindre ses proches. Il fallait vivre, continuer à sortir de chez soi, sans pouvoir partager ses inquiétudes. Ce décalage ahurissant a rendu ma mère folle, répétant à l’envi qu’elle aurait préféré être sous les bombes au Liban qu’à Paris dans cet état flottant. C’est dans cette désillusion que réside la brutalité : elle qui croyait quitter la guerre en quittant le Liban, n’a rien quitté du tout, c’est même pire de loin. Tous les enfants libanais de ma génération ont assisté à cela. Dépositaires de cette charge émotive, chacun de nous se débrouille pour gérer cet héritage-là ; pour ma part, c’est en écrivant.
-
Entretien réalisé par Marie Bey et Fanély Thirion, octobre 2021