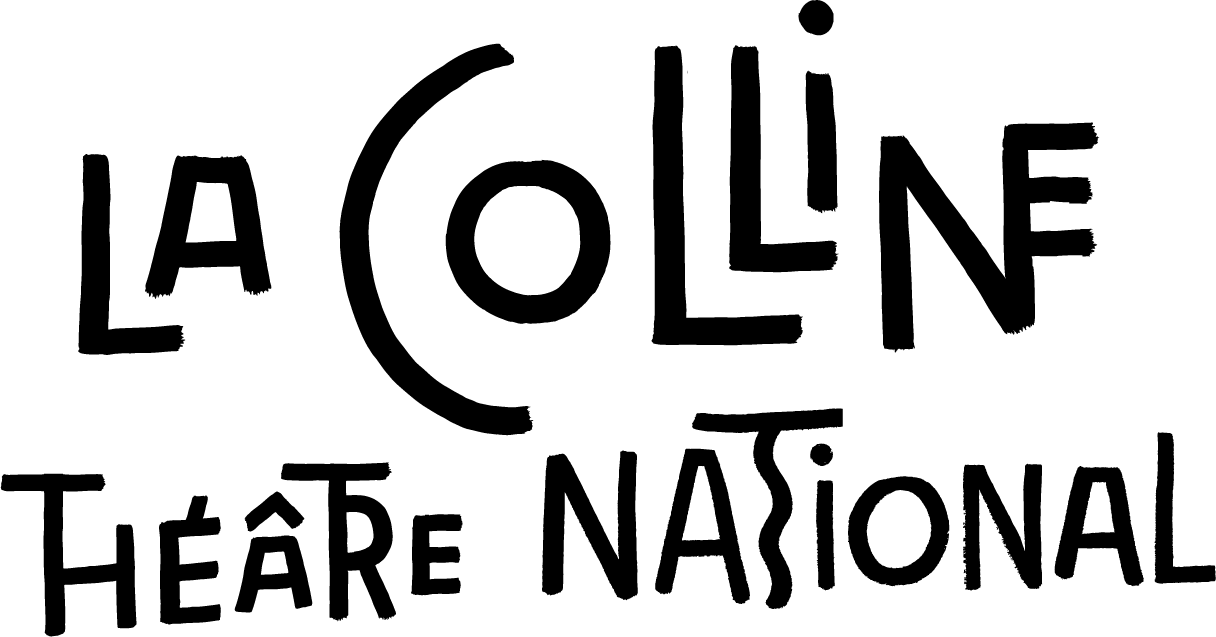Journal de création
Entrez dans les coulisses de la création Journée de noces chez les Cromagnons de Wajdi Mouawad à travers le regard de l'équipe artistique.
Promesse
[1ère semaine de répétitions à La Colline]
4 - 9 mars 2024
Les premières heures, les premiers jours, nous nous regardons comme ceux qui se découvrent et ne se connaissent pas encore. La distance pourrait paraître plus grande que d’habitude, du fait de la langue et des pays dans lesquels nous vivons, le Liban, la France, le Québec pour Aïda , qui a émigré il y a quelques années, du fait aussi peut-être de la proximité des Libanais avec la guerre qui se tient à Gaza. Pourtant nous sommes tous déjà reliés par ce qui nous convoque dans ce lieu. Les fils sont invisibles, à découvrir et à tisser, mais on sent leur présence.
Autour de la table nous sommes une vingtaine, acteurs, concepteurs et techniciens. Ce qui nous réunit porte le nom de Journée de noces chez les Cromagnons, l’une des premières pièces de Wajdi, écrite à Montréal en 1990. Il ne l’a jamais mise en scène. Après Mère et Racine carrée du verbe être, alors qu’il s’interrogeait sur la suite, est née l’envie de revenir vers deux textes, dont les échos avec l’époque le troublent, Willy Protagoras enfermé dans les toilettes et Journée de noces chez les Cromagnons, de revenir vers ces textes et de les mettre en scène, comme un diptyque : l’un dans la petite salle et l’autre dans la grande, l’un en libanais, l’autre en français. Et déjà l’imaginaire d’un dialogue, entre deux lieux, entre deux langues, entre deux époques.
Journée de noces chez les Cromagnons poursuit le mouvement de Mère, en faisant un pas supplémentaire : car il ne s’agit pas seulement cette fois de jouer en libanais, de travailler avec des acteurs libanais, mais de créer le spectacle au Liban, d’abord au Liban. Et c’est même le cœur du projet : créer à Beyrouth, en répétant dans les deux villes, Paris puis Beyrouth et en mélangeant les équipes, acteurs, concepteurs, techniciens. Créer au Liban et rendre possible une rencontre, un mouvement, de l’orient vers l’occident, de l’occident vers l’orient.
Ce déplacement opère dès les premières heures, dès les premiers jours, par le travail qui les occupe. Car autour de la table c’est sur la traduction que se porte d’abord l’attention. Une première version du texte a été établie par Odette et Wajdi. Il s’agit désormais de l’éprouver et de la retravailler avec l’ensemble des comédiens libanais, Aïda, Fadi, Bernadette, Layal et Aly. Pendant quatre jours, chaque réplique est écoutée et ciselée, pour parvenir au mot, à l’expression la plus juste. Au cours de ces séances, Wajdi raconte son trouble, découvert sur Mère : cette sensation non pas d’être traduit, mais « détraduit ». Comme s’il avait toujours écrit en arabe, comme si en arrière des mots qu’il employait se tenait depuis toujours cette autre langue, maternelle. Comme si la cosse qui l’enveloppait était enfin retirée. Tout sonne soudain à ses oreilles, la musique, le rythme, les timbres, tout sonne comme il l’avait toujours imaginé.
Tandis que j’écoute assise à cette table, ces premières heures, ces premiers jours je fais partie d’un « nous » surgi de fait, celui des francophones, des seuls francophones. Nous écoutons. Nous écoutons cette langue que nous ne comprenons pas, nous voyons leurs mains écrire dans un alphabet que nous ne savons pas lire, nous observons les échanges, les débats, les rires, sans pouvoir y participer. Nous tentons de suivre mais tout nous échappe. Alors qu’Aly, Layal, Bernadette, Fadi, Aïda, entrant dans ce théâtre, descendant les marches qui conduisent à cette salle en sous-sol, s’asseyant à cette table, étaient les étrangers, nous le sommes devenus. Comment ne pas sentir naître peu à peu un sourire sur nos lèvres devant cette inversion ? Le premier déplacement. La magie du théâtre. Qui nous fait changer de place et vivre l’expérience de l’autre. Et si pendant quelques instants cette salle de répétition semble transportée à Beyrouth, ce qui apparaît peu à peu est plutôt la promesse d’autre chose, d’un autre lieu : un pays qui n’existe pas, ou pas encore, et s’inventera de cette rencontre, à l’intersection des points que nous sommes, pour offrir un nouveau « nous ».
_
Charlotte Farcet, dramaturge
dimanche 10 mars 2024
Équipe de création
Fadi Abi Samra, Cyril Anrep, François Bombaglia, Josyane Boulos, Emmanuel Clolus, Griet De Vis, Hagop Der Ghougassian, Jean Destrem, Layal El Ghossain, Arnaud Godest-Xie, Charlotte Farcet, Mohamad Farhat, Michelle Feghali, Isabelle Flosi, Aurélien Hamon, Aly Harkous, Bernadette Houdeib, Stéphanie Jasmin, Cécile Kretschmar, Mathilde Langevin, Marion Le Strat, Annabelle Maillard, Odette Makhlouf, Laurent Matignon, Nadim Mishlawi, Eric Morel, Wajdi Mouawad, Elsie Moukarzel, Lisa Ravelomanantsoa, Solenn Réto, Aïda Sabra, Etienne Seukunian, Claire Tavernier, Gilles Thomain et les équipes des ateliers de La Colline
photo de répétitions © Eric Morel
Partition
[2e semaine de répétitions à La Colline]
11-16 mars 2024
C’est la première fois que nous travaillons sur un texte de Wajdi déjà écrit. Jusqu’à présent, l’écriture se tissait au fil des répétitions. Nous étions réunis autour d’une histoire que portait Wajdi et du récit qu’il nous en faisait. C’est ainsi que nous rencontrions les personnages. Nous avions parfois les premières scènes, le premier acte, jamais plus. Le texte s’écrivait en même temps que le spectacle se construisait, en parallèle du moins, comme un fil souterrain qui dédoublait les journées de Wajdi. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Nous ne connaissions jamais la fin et naviguions en pleine mer, incertains de la terre qui apparaîtrait.
Là, le texte est écrit, il est même publié et a plus de trente ans – ce qui ne veut pas dire qu’il est immuable, il reste une matière et peut être modelé. Mais c’est une sensation tout à fait nouvelle, qui déplace le travail et libère un espace. Wajdi n’est pas le même face au plateau, son attention, comme la nôtre, ne se porte pas sur l’histoire ou la construction narrative, sur la justesse ou la pertinence ou l’équilibre d’une scène, elle se porte sur la mise en scène. C’est-à-dire la mise en voix, en corps et en espace des répliques. C’est ce qui me frappe tandis que nous travaillons ce premier acte. La nature du texte participe de ce changement. Wajdi, troublé, évoque d’ailleurs des sensations anciennes, lorsqu’il dirigeait ses premiers spectacles – avant qu’il ne s’attache à des récits plus longs et épiques. Journée de noces chez les Cromagnons est écrit comme une partition musicale. La pièce écrite en 1990 est une pièce en cinq actes, qui respecte rigoureusement la règle des trois unités et reprend le motif familier du mariage d’une jeune fille mais en transportant ces éléments dans un contexte radicalement différent des œuvres classiques : un pays en guerre, où tout est déréglé, brutal et défiguré, où la parole ne se dit pas mais se crie. Ce premier frottement entre l’ossature et la chair – et écrivant ces mots je vois le mouton tué pour les noces dans ce premier acte et son leurre si saisissant conçu par les accessoiristes – ce premier frottement donc crée une tension qui se diffuse dans la moindre réplique. Chaque acte n’est qu’une seule et même scène, un plan séquence dit Wajdi, qui file comme une flèche. Les répliques sont courtes, vives, précises, s’échangent sans qu’une respiration ne soit prise ou laissée. Le rythme est clef et c’est à lui que Wajdi s’attache au cours de cette semaine. Il sculpte, façonne, cisèle, pour le trouver et le tenir. Et tout en le cherchant, il nourrit les acteurs des strates des personnages, de leurs silences et de leurs complexités. Rien ne doit être expliqué mais tout doit être là. En un instant, une coupe.
Ce qui à la lecture pouvait surprendre, l’état soudain d’un personnage, l’état soudain de la langue, devient peu à peu sur le plateau évidence, comme si cette cadence permettait de comprendre, d’accéder à un autre niveau de réception, physique, intuitif, émotif. Quelque chose s’éveille en nous qui échappe à la raison. Le rythme nous pénètre comme le son d’un tambour, d’une percussion, il nous conduit aux personnages, comme si notre respiration, nos battements cardiaques venaient épouser les leurs. La pièce doit travailler à la capture, au rapt du spectateur, ne pas lui laisser le temps, l’espace de la réflexion pour lui faire ressentir cette précipitation qui est tout à la fois angoisse, urgence et fuite en avant.
Rien donc ne peut être imprécis, le moindre geste fait partie de ce château de cartes. Wajdi place chaque réplique, chaque regard, chaque geste. Nous répétons encore et encore une même séquence de quelques lignes, pour trouver une précision millimétrique. La mécanique d’une horloge. Il chasse les scories, travaille l’immobilité et le mouvement, la parole droite et l’arabesque. Les regards sont des répliques, dit-il, les mouvements sont des répliques, le son est une réplique. Et il apparaît évident peu à peu qu’il écrit, avec les corps. Qu’il travaille chaque détail comme il travaille le mot, la phrase. Et ce travail de plomberie si présent dans l’écriture, le voilà au plateau.
_
Charlotte Farcet, dramaturge
dimanche 17 mars 2024

photo de répétitions © Eric Morel
Chair
[3e semaine de répétitions à La Colline]
18-23 mars 2024
Quelque chose se déplace au cours de cette semaine, notre regard, notre relation à la pièce. Jusque-là nous gardions une forme de distance, de séparation. Nous travaillions, nous nous attachions à déployer le texte en donnant corps aux mots, aux lieux, aux sons. Les répétitions étaient concentrées, chacun à sa tâche. Nous avancions. Mais au cours de cette semaine quelque chose se déplace – et me viennent même d’autres verbes, bascule ou s’inverse. La pièce nous précède. Je ne sais pas quand ce passage a eu lieu, mais soudain c’est là, une sensation, qui vient se coller à la peau, désagréable, pénible. Nous enchaînons trois scènes du deuxième acte, travaillées en désordre, et tandis que nous regardons, assis dans le noir, derrière la ligne sage de nos tables faisant face au décor, tandis que nous regardons prêts à prendre des notes, quelque chose vient à nous, vient à nous et nous arrête, retient nos mains. Nous n’observons plus la carcasse du mouton dépecé avec le rire de l’acte I où, de façon grotesque, il était mis à mort, où la folie des personnages tenait de la fureur, de l’excès, de l’hystérie. Non, désormais le mouton nous observe. Et nous avons sur nos peaux la sensation de sa peau, sur notre chair de sa chair, sur nos os de ses os, comme si nous étions dans sa carcasse, à l’intérieur de sa carcasse, et sentions la lame qui le détaille. Les choses se troublent. Prenant corps, la pièce s’est mise à exister, à flotter dans la salle, elle est devenue une présence concrète, presque autonome. C’est elle qui nous travaille désormais. Et Bernadette, Souhayla, la voisine, de dire un soir à la fin de la répétition : « je sens l’odeur du mouton, je sens l’odeur de la viande. » Fadi joue à écorcher, à dépecer, avec un couteau dont la lame a été émoussée, ses mains sont tâchées par un pigment rouge, préparé comme le couteau, comme la carcasse, par Claire, François et Griet, et pourtant nous voyons du sang, nous goûtons le sang. « Je sens l’odeur du mouton », dit Bernadette. Derrière nos tables, nous sommes envahis par cette sensation collante, poisseuse. Quelque chose est devenu oppressant. Est-ce d’entendre aussi ces bombes qui tombent sans cesse, d’entendre les tirs des francs-tireurs ? Est-ce l’écho évident avec ce que nous lisons chaque jour dans les journaux, ce réel qui se rappelle à nous ? Est-ce le corps des acteurs, Bernadette, Fadi, Aly, Layal et Aïda ? Car Wajdi le dit : « lorsque je travaille avec des acteurs québécois ou français et qu’ils prononce le mot guerre, j’entends toujours un espace entre le mot et le corps ; si un acteur français dit résistance, ou collaboration, je n’entends pas cet espace, mais guerre, bombardement, sa chair reste muette. Là, non. Vous dites guerre et tout vibre. Harb. » Je crois que c’est vrai. Que sans le comprendre, nous recevons cela, l’expérience de leur chair, leur vulnérabilité, et cette défiguration.
Tout travail de répétition arrive souvent à un tel moment, où l’œuvre déteint et délave, où nous l’emportons hors de la salle, où ce n’est plus nous qui travaillons mais elle, oui, qui nous travaille. Sans doute est-ce une étape nécessaire, qui nous met à égalité avec le spectacle. Et nous oblige. Car nous ne pouvons en rester là. Nous ne pouvons être médusés. Ce qui se passe dans ce moment où nous avons la sensation d’entendre réellement un texte, la sensation de voir réellement un texte, est aussi le risque d’un aveuglement. Se laisser noyer, submerger et perdre de vue le spectacle qui, lui, demande à être construit, à être regardé encore comme une matière, à être entendu pour lui, et non à travers l’écho qu’il produit en nous. Ne pas rester trop longtemps spectateur.
Cela, je m’en rends compte au dernier filage et c’est comme un réveil. Où est-ce même la première fois que mon cerveau se met en mouvement, s’engage réellement, se met à réfléchir ? Nous enchaînons les deux premiers actes, pour la seconde fois de la journée, il s’agit déjà de la moitié du spectacle, et ce filage est plus rythmé, plus vif. Il laisse entrevoir autre chose, insaisissable encore, flou encore, l’endroit où nous devons travailler, que nous devons interroger et construire, encore. Et soudain je sens que je suis regardée, que nous sommes regardés. Par le spectacle lui-même, un sourire aux lèvres. Il nous observe, nous attend, attend que nous continuions à le sonder pour faire sourdre autre chose, aussi autre chose, de plus large, de plus puissant. Si ce réveil est vivant, il est aussi inquiétant, car le chemin est entre nos mains et pourrait nous échapper, un chemin non plus à suivre mais à découvrir, à inventer. Journées de noces chez les Cromagnons n’est pas qu’une partition. Tout n’y est pas écrit.
_
Charlotte Farcet, dramaturge
dimanche 24 mars 2024
 photo de répétitions © Eric Morel
photo de répétitions © Eric Morel
Horizon
[4e semaine de répétitions à La Colline]
25-30 mars 2024
Le temps s’accélère, comme si tout nous portait déjà vers le dernier jour de cette dernière semaine parisienne. Chaque jour nous rapproche de cette fin. Ce n’est pas un décompte, plutôt un horizon qui nous aimante. Nous savons que le pas suivant sera Beyrouth et voilà que nous y sommes, ou presque, et ce « presque » nous rend fébriles. Nous savons que cet horizon est l’âme du projet, tout à la fois sa prémisse et sa destination. Depuis longtemps déjà une pierre a été lancée vers ce point d’arrivée et nous sentons l’arc s’infléchir. Ce qui nous échappe bientôt prendra corps, trouvera son pouls, sa vibration, sa forme. C’est une drôle de chose quand on y pense, dans ce projet où on attend un fiancé, où on prépare une noce. « À quelle heure arrive le fiancé ? », demande le personnage de Souhayla à celui de Nazha. « À 16h, comme tous les fiancés ». « Que reste-t-il à faire ? ». « Préparer les courgettes, les aubergines, la farce de riz. »
Samedi, après avoir filé les trois premiers actes, c’est déjà autour d’une table que nous nous retrouvons pour fêter la fin de cette première période et le prochain départ. Nous nous disons au revoir, à très bientôt, dix jours à peine. À Beyrouth cependant n’auront pas lieu seulement des retrouvailles. Nous rencontrerons aussi ceux qui depuis des semaines, parfois des mois, travaillent à ce projet : Josyane, la directrice du théâtre Monnot, Hagop, son directeur technique, Ahmed, son adjoint, Elsie, la scénographe qui supervise dans un atelier à Beyrouth la construction du décor, Michelle qui cherche les accessoires. Et d’imaginer toutes les conversations, tous les échanges qui, en arrière et depuis si longtemps, ont tissé cette toile. Pendant ces quatre semaines passées en salle de répétition, au sous-sol de La Colline, nous ne travaillons que sur la partie visible de l’iceberg. Et la partie immergée est considérable. Il est difficile de la mesurer, de mesurer tous ces mois passés à construire et à inventer, d’une ville à l’autre, d’un pays à l’autre, tout ce travail souterrain et parallèle. Cet autre présent, ce second présent. Journée de noces a exigé de ceux qui l’ont porté et pensé un don d’ubiquité. Et exige de nous désormais une responsabilité. Car comment oublier l’émotion d’Odette en décembre dernier, elle qui a tant servi de lien, à l’idée que tout pouvait s’effondrer devant la guerre qui ravageait la région, s’effondrer encore une fois, disait-elle, une nouvelle fois, comment oublier son désarroi ? L’importance de ce projet n’est pas seulement artistique, ou plutôt sa nécessité n’est pas seulement celle de l’équipe artistique, elle est celle de tous ceux qui depuis des mois se sont engagés, de part et d’autre. Et cette nécessité nous convoque, oui, à un endroit de responsabilité. Poursuivre non pas seulement pour créer mais pour dire que ce lien est possible, la continuité de ce lien. Ne pas couper le fil et faire que les promesses se tiennent.
« À quelle heure arrive le fiancé ? », demande Souhayla à Nazha. « À 16h, comme tous les fiancés ». À quelle heure arrive Beyrouth ? Bientôt. Dans quelques jours.
_
Charlotte Farcet, dramaturge
dimanche 31 mars 2024
photo de répétitions © Eric Morel
Semaines fantômes
1er-20 avril 2024
Il n’y aura pas de noces à Beyrouth. Je pensais n’écrire que cette phrase. Parce que depuis le retour mes pensées sont courtes et que c’était à elle sans cesse que je revenais. Parce que je préférais écarter la phrase qui inéluctablement lui succédait, dans un rebond ironique, issue du texte lui-même comme s’il m’attendait avec un sens parfait du timing et de la répartie : « Que leur dirons nous ? ». La question dans Journée de noces est posée par Nazha et conduit à la réponse amère et cinglante de Néyif : « Que les étrangers sont tous des salauds. Ils seront d’accord, on mangera ensemble et tout le monde sera content ». Conclusion toute trouvée pour sortir du canular dont ils sont les instigateurs – le mariage de Nelly – et qui accuse le fiancé européen – qui n’existe pas. Hors contexte la phrase paraît d’une ironie tragique. Comment s’en satisfaire ? Et comment ne pas s’en sentir glacé ? Pendant les tout premiers jours de ce retour je tentais de rassembler mes pensées, avec la sensation d’être prisonnière d’une situation qui m’échappait, à la fois là et pas là, et me revenait le mot d’ubiquité, utilisé juste avant le départ, et celui de promesse. Chacun des textes précédents se repliait pour devenir presque sarcastique. Et puis, comme si Journée de noces me poussait plus loin au dialogue, je me suis rappelée qu’il existait une autre réponse à la question de Nazha, quelques pages après, faite par Neel, le frère de Nelly, témoin blessé des affabulations de sa mère : « On dira que le fiancé n’a pas pu venir à cause de la situation et on reportera le tout à une date ultérieure ». Et cette fois de sourire, préférant cette réponse, la situation, le report, d’une coïncidence étonnante puisque tout déjà, trois jours après le retour, s’organisait pour reprendre. J’avais dès lors une nouvelle suite dans la tête : « Il n’y aura pas de noces à Beyrouth », « Que leur dirons-nous ? », « Que le fiancé n’a pas pu venir à cause de la situation. Et qu’on reportera ».
Mais quelque chose restait insatisfaisant : j’avais la sensation de troquer un lieu pour un autre, une date pour une autre, tout en restant à la merci des circonstances. Comment alors parler de promesses ? Et comment les tenir ? Je songeais à cela tandis que je marchais dans un bois voisin et longeais un chemin qui mène à un lac et une baraque à frites – il faut bien des consolations –, sinuant encore dans Journée de noces. Jusqu’à ce que soudain l’évidence me saute au visage : mais il y a une noce. Il y a une noce et il y a un fiancé. Je dévoile une partie de l’histoire, mais après tout le texte est publié et la matière qu’il offre pour réfléchir est plus importante désormais. Il y a une noce oui, et un fiancé, que personne sauf Nelly n’attendait. Longtemps je n’ai vu cette apparition que comme le cou tordu aux préjugés de chacun, des voisins comme des proches, de Nazha et Néyif, qui ne pouvaient imaginer de fiancé à leur fille narcoleptique, je la voyais comme le refus d’une condamnation, une foi dans la foi de Nelly qui, pourtant plongée dans le sommeil par l’horreur de la guerre et visitée par des visions cauchemardesques, jamais, elle, ne doutait. Je la voyais comme une variation drôle et cocasse du deus ex machina des comédies de Molière. Et puis, à cause d’une idée de Wajdi – le jeune homme est l’auteur de la pièce, j’y reviendrai – je me suis mise à voir cette arrivée comme une chose mystérieuse que je ne comprenais pas tout à fait et n’aurais su expliquer ou interpréter, mais qui me semblait terriblement juste. Une chose qui avait à voir avec l’engagement de l’auteur envers son personnage. Il y a une noce, il y a un fiancé. Et tandis que je marchais donc dans ce bois, soudain je me suis dit qu’il existait peut-être une autre manière de regarder les choses, une autre manière de réaliser ces noces, un autre lieu, non pas le lieu concret, la ville, la destination où le plateau aurait dû se poser, mais le plateau lui-même, ce n’était pas, non, le lieu qui comptait, mais le fait simplement de rester concentré et de continuer, de travailler dans le noir, de travailler au noir, c’est-à-dire à l’oubli même des lieux, pour que n’en existe plus aucun autre que celui de la pièce à l’instant de la représentation. Il y a mille façons de tenir ses promesses.
Tandis que je marche toujours sur ce chemin, les associations soudain sont rapides et je réalise, déçue, que je reviens toujours au même mot, promesse. Est-ce que je tourne en rond ? Et je pense à mon professeur de philosophie alors que j’étais étudiante, Alain Cugno, qui, de quelques traits, signait toujours ses copies d’un âne, malicieux, bienveillant, dont la tête reprenait l’initiale de son nom. Alain nous exerçait à une épreuve orale, nous tirions au sort un sujet et disposions d’une heure pour le préparer et le lui soumettre. Il n’attendait jamais un exposé précis ou académique, mais nous invitait à interroger le mot ou plutôt à le laisser, lui, nous interroger, pour écouter ce qu’il faisait naître en nous, sa diffraction en nous. Promesse aurait pu être un de ces mots. Ce spectacle pousserait-il à cet exercice ?
Alors revenons au fiancé. Je disais au début de ce journal que pour la première fois nous travaillions sur un texte déjà écrit, puis que non, en réalité, tout ne l’était pas. En effet, tout ne l’est pas. Mettant en scène Journée de noces trente ans après son écriture, Wajdi a senti, au-delà des coupes et des modifications à apporter – la suppression d’un personnage, la fusion des deux derniers actes – la nécessité d’une perspective. Non pas celle du temps passé, de ces trente années passées, mais celle du présent de l’écriture. Il introduit donc un autre personnage pour incarner ce moment et ce lieu, et figurer le point de vue de ce personnage, l’auteur, ou plus précisément la situation depuis laquelle il écrit. Et d’apporter ainsi au spectacle un centre de gravité à partir duquel la pièce lui semble plus juste. Depuis le début des répétitions nous travaillons donc à tisser la présence de ce jeune homme – c’est ainsi que nous l’appelons, le jeune homme, son nom n’est pas encore décidé, il a même été retardé par ces dernières semaines, mais parfois celui de Harwan a été utilisé pour sa proximité avec le personnage de Seuls – nous travaillons à tisser et entrelacer sa présence avec la pièce elle-même. Il ne s’agit pas pour Wajdi d’en faire un personnage central, au contraire, seulement de donner à Journée de noces cet arrière-plan, en contre-point : un garçon d’une vingtaine d’années, à Montréal, au début des années 90, assiégé par la neige, tentant d’écrire une pièce sur la guerre qui l’a chassé à des milliers de kilomètres du pays qui était le sien. Donner à sentir cette distance, cet écart, sans rien dire d’autre que cette concomitance, ou cette inclusion. C’est ce jeune homme qui sera le fiancé.
Dans mon imaginaire, ce jeune homme a les traits de Jean qui le joue. Et lorsque je le regarde, assis derrière la fenêtre inscrite dans le mur de fond du décor, penché sur sa machine à écrire, ce n’est pas seulement Wajdi que je vois, à vingt ans, mais grâce aux traits de Jean, chacun de nous dans cette salle. Et je devine, dans le noir, que nous sommes plusieurs à être traversés par cette pensée. Son visage est le nôtre à vingt ans, sa jeunesse la nôtre. Et suivant cette ligne, il m’est difficile, toujours assise derrière cette table, à quelques mètres du bord du plateau où Wajdi navigue tandis qu’il dirige les acteurs, de ne pas mettre en dialogue le corps du présent avec celui du jeune homme, de ne pas mettre en dialogue les âges, les époques. Et aussi bien pour Wajdi que pour nous. Car de même que Jean est une figuration de chacun de nous, Wajdi l’est devenu. À travers eux, nous sommes pris dans ce prisme du temps. Passé et présent. Et Journée de noces représente nos promesses. Ce dialogue n’a rien à voir avec la pièce, il lui est extérieur, se tient presque à son insu, dans ces répétitions. Ou dans l’absence de ces répétitions. Comment par exemple ne pas penser au sol qui s’est encore dérobé sous les pieds de Wajdi ? Et à cette impossibilité de créer encore à l’endroit de la source ? Comment ne pas penser à ce présent qui n’est pas là où il devrait être, mais encore déplacé ? Comment ne pas mettre en dialogue, oui, tous ces visages du temps, les uns ignorant l’avenir, les autres au contraire trop conscients du passé ? Je sais que la question qui obsède Wajdi est aussi celle de la trahison et de la promesse. S’il n’est pas toujours possible de tenir nos promesses, du fait de circonstances extérieures, indépendantes de notre volonté, trahissons-nous celui ou celle que nous avons été ? Comment tenir nos promesses envers nous-mêmes ? Et comment continuer à promettre ? Comment nos expériences d’aujourd’hui façonnent-elle nos promesses de demain ? Oublierions-nous non plus seulement de les tenir mais de les formuler ? Aurions-nous renoncé à cette part en nous de désir, d’absolu, d’innocence ? Même infime, notre devoir n’est-il pas de tenter de la préserver ? En résistance. En secret. Que cette herbe jamais ne puisse nous être arrachée. Ce lieu intérieur. Et soudain je pense à Talyani dans Racine carrée du verbe être qui revient s’asseoir à la fin de sa vie à la table où l’attend le garçon de dix ans qu’il était. Ce qui compte peut-être n’est pas le chemin, mais précisément ce dialogue. Rester toujours en dialogue avec soi-même.
_
Charlotte Farcet, dramaturge
dimanche 21 avril 2024
Reprise
[5e semaine de répétitions à La Colline]
26 avril-4 mai 2024
Le mot reprise me fait toujours songer à ce documentaire, vu il y a presque trente ans, sur la reprise du travail dans les usines Wonder, en juin 1968, ou plutôt sur la recherche d’une jeune femme apparue sur des images tournées alors, refusant de reprendre le travail. Je ne sais pas pourquoi ce film m’a tant marquée, est-ce le visage de cette femme, en noir et blanc, protestant avec fureur, est-ce l’obsession du réalisateur, Hervé Le Roux, si troublé par elle qu’il construit un film pour la retrouver plus de vingt ans après ? Ou est-ce sa tentative de ne pas laisser seule cette douleur, seule et en cet instant-là, de ne pas l’abandonner à ce seul fragment-là ? Maba’rif, diraient les Libanais : je ne sais pas. Le film revient sans cesse sur cette séquence si brève, dans mon souvenir du moins, il la reprend et la reprend encore, comme à la recherche d’un indice, d’une clé, qui lui aurait échappé et qui permettrait de saisir quelque chose de cette femme devenue un mystère. C’est ce visage que je vois depuis, lorsque j’entends « reprise », ce visage qui crie, celui de cette femme devenue pour moi un personnage, la figure d’une douleur et d’une rage qui n’est pas si étrangère à celle de Nazha, c’est ce visage que je vois, et ce geste, chercher et creuser inlassablement, comme dans ce verbe employé si souvent en salle de répétition, « reprends », « on reprend ».
Nous avons repris donc. Nous avons repris là où nous en étions, tels que nous étions. Et en quelques jours à peine, nous avons eu toutes les pièces du puzzle.
En arrivant à Beyrouth, nous devions retraverser les trois premiers actes avant d’entrer dans le quatrième, mais reprenant, nous avons choisi d'y travailler directement. Une impatience sans doute, l’envie d’avancer plutôt que de revenir en arrière, l’heure juste. « Quatre heures », dit Neyif en ouverture de cet acte, l’heure à laquelle arrivent les fiancés. Une manière de dire : nous y sommes. Quatre heures donc, et ce quatrième acte. Avant de partir, Wajdi l’avait réécrit, en fusionnant les deux derniers actes de la pièce initiale pour supprimer le personnage de Walter. Mais très vite, le texte s’est dérobé. Passées les premières répliques, le plateau nous a poussés plus avant, indiquant un chemin encore plus court et plus rapide, comme s’il soufflait qu’après tant d’attente et de mots, tant de bavardage et de mascarade, il fallait aller droit au but. Un mouvement qui est celui des personnages : arrivés là, ne compte plus pour eux que l’essentiel, vivre, ou mourir. C’est aussi simple que ça, aussi abrupt que ça. Et même s’il reste un plan séquence, l’acte devient cette juxtaposition d’instants, de la violence à la joie, de la joie à la violence. Tout y bascule en un claquement de doigt.
Nous avons donc désormais toutes les pièces du puzzle, même si nous ne les avons pas encore assemblées. Bien sûr je reste troublée par l’idée que si nous l’avions répété à Beyrouth deux semaines plus tôt, ce dernier acte aurait été différent. Il aurait porté autre chose, de façon concrète et diffuse, l’empreinte de la ville qui nous aurait entourés, l’empreinte de ceux qu’alors nous aurions été. En un autre lieu, en un autre temps, nous n’aurions pas été les mêmes, nos choix l’auraient-ils été ? Aurions-nous réordonné et coupé le texte ? Nazha aurait-elle eu ce rire au début de l’acte ? Souhayla serait-elle entrée si tôt ? Les personnages se seraient-ils tous assis sur la banquette ? Jean aurait-il parlé à Nelly ? C’est une sensation troublante, qui donne à sentir la force des hasards et des circonstances. D’une certaine manière, cet autre quatrième acte existe, à côté de celui que nous avons composé. Nous avons toutes les pièces du puzzle, avec à l’endos même d’autres pièces, invisibles. Mais nous ne sommes pas au complet. Une partie de l’équipe manque à cette reprise, restée au Liban. Elle devait participer à cette création et l’accompagner. Cette absence est concrète, tangible, et crée un vide que nous tentons d’habiter. Ce quatrième acte invisible est le leur et chacun de nous espère, je crois, leur rendre.
_
Charlotte Farcet, dramaturge
dimanche 5 mai 2024
photo de répétitions © Eric Morel
Les mauvaises herbes
[6e et 7e semaines de répétitions à La Colline]
6-18 mai 2024
Les pièces sont assemblées et la fin approche. La dernière semaine a été dédiée à des filages en condition de représentation, comme si nous jouions le 17 mai. La première aura lieu le 7 juin, à Montpellier, mais nous n’aurons pas le temps d’ici là d’autres répétitions. Sept filages sont déjà une grande chance. En les regardant, j’ai souvent pensé au jeune homme de vingt ans qui avait écrit ce texte, et au fait que nous venions d’en achever la mise en scène, trente-cinq ans après. Que penserait-il aujourd’hui ? Comment regarderait-il ce spectacle ? Se sentirait-il heureux ou trahi ? Au fil de ces filages, j’ai senti le spectacle apparaître, trouver son rythme, sa musique, son autonomie. Ce moment coïncide toujours aussi avec un autre : celui où le spectacle échappe. On prend la mesure soudain des choix qui ont été faits et on sait que chacun porte le deuil d’autres chemins. Des dizaines d’autres chemins, de bifurcations, c’est-à-dire de possibles, abandonnés. Il y a dans le geste de création, ce geste qui conduit à porter vers l’autre une intuition, une sensation, la nécessité de donner une forme et donc de construire, d’ordonner, de choisir. Ainsi l’objet pourra-t-il être appréhendé et un regard se poser. Même lorsque la forme ne semble pas finie ou aboutie, elle existe. Celui qui regarde prend l’objet tel qu’il est. Même lorsque l’œuvre porte un désir d’infini, il n’en reste pas moins que l’objet, lui, est fini. Un tableau a un cadre, une sculpture des limites physiques, un livre un nombre de pages, une pièce une durée. Dans cet ordre que l’on crée, dans ce travail de choix et peu à peu d’achèvement, de finitions – comme ces derniers jours de répétitions où nous étions attentifs au moindre détail, l’ombre d’une lumière, la place d’un surtitre, le verre sale d’une fenêtre, le rythme de la neige qui tombe, la couleur d’un tablier – dans ce travail sans cesse des décisions sont prises, qui sont l’expression d’une maîtrise, dont nous portons simultanément le regret. Regret de la matière brute, du désordre, sur lequel on pouvait projeter tant de rêves, regret de l’accident qui pouvait surgir, de la mauvaise herbe. Les brouillons sont parfois si impressionnants. Je me souviens par exemple d’une répétition qui fut l’un des plus beaux moments de théâtre auxquels j’ai assisté. Ce moment où Créon, comprenant qu’il vient de perdre son fils, perd l’esprit. Patrick Le Mauff l’incarnait, et une fraction de seconde Patrick a été Créon. Là, sous nos yeux, il s’est défait et a perdu l’esprit, appelant, fou de douleur, presque en riant, à l’aide, d’une voix qui était tout à la fois celle d’un vieillard et d’un enfant, pleurant et riant encore, jusqu’à croire voir paraître devant lui le fantôme de son fils et se mettre à danser. C’était saisissant. Comment donner à voir ces instants si fragiles qui surgissent dans les moments de recherche ? Comment les retrouver ?
Les brouillons, oui, nous semblent souvent plus intéressants, parce qu’ils contiennent le premier jet, cet échevelé, cet à peine-né, qui, dans notre sensation du moins, se rapproche encore de l’organique. On définit souvent une œuvre comme un objet qui n’existe pas dans la nature. Cet attachement au brouillon tient peut-être au fait que, dans cet état, l’objet semble le plus proche possible, encore, de la nature, parce que lié, encore, à son auteur, son porteur. Ce n’est pas le rêve d’une signature qui s’exprime là, au contraire. C’est le rêve presque d’une disparition, le rêve de ce qui échappe et n’aurait pas reçu l’empreinte de notre volonté.
Pourtant il faut construire, ordonner et choisir, ou le spectateur n’y comprendrait rien. Il ne trouverait pas sa place. Alors la question qui nous habite est celle-ci : avons-nous fait le bon choix ? Qu’en est-il de tous ces autres chemins ? Le spectateur pourra-t-il les pressentir ? Reste-t-il des traces de ces sentiers, de ce vrac ? Une odeur, une âme ? Comment, oui, transmettre l’âme d’un projet ? Wajdi, je crois, en montant Journée de noces chez les Cromagnons, tenait justement à ne pas trahir celle de ce jeune homme, à ne pas réécrire la pièce avec son regard d’aujourd’hui, à garder les mauvaises herbes.
On aimerait parfois pouvoir présenter tous les possibles, non pas les possibles d’une histoire, mais les possibles d’un geste. Et pourtant on sait que ça n’aurait aucun intérêt. Que ça noierait seulement l’autre. Il faut faire le pari d’un chemin pour espérer faire naître chez l’autre le sentiment que l’on porte, prendre le risque d’un chemin, et sacrifier sa peur. Parce qu’au fond c’est ainsi, c’est comme ça. Il n’y a pas d’autre voie.
_
Charlotte Farcet, dramaturge
dimanche 19 mai 2024

photo de répétitions © Eric Morel